Par Hichem ABOUD
Faire le bilan d’une politique publique, surtout dans les pays du tiers-monde, relève bien souvent du parcours d’obstacles. Non pas en raison d’une absence d’éléments d’évaluation, mais parce que la critique y est perçue comme une offense, voire comme un acte de trahison.
Dans bon nombre de pays arabes, le débat objectif est verrouillé, les médias sont muselés, et les gouvernants s’entourent d’un cercle de courtisans prompts à chanter les louanges d’un pouvoir autiste à toute remise en question. Dans cet univers figé, le discours officiel oscille entre autocongratulations grotesques et déni de réalité, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Mais il est des exceptions. Le Maroc en fait partie. Lorsqu’on s’intéresse à la politique étrangère marocaine, en particulier celle menée sur le continent africain, l’observateur sérieux, honnête et objectif n’a guère de mal à dresser un constat clair, fondé et irréfutable. Il n’est nul besoin de discours enjôleurs ni de propagande tapageuse : les faits parlent d’eux-mêmes, les chiffres étayent les dynamiques, les réalisations concrètes illustrent la vision stratégique du royaume.
En Afrique, la politique étrangère marocaine n’est pas un simple axe diplomatique : elle en est la colonne vertébrale. Bien avant de briller sur la scène internationale, le royaume a méthodiquement bâti sa stature de leader africain, en misant sur un partenariat fondé sur la crédibilité, la constance et la confiance.
Cette influence n’a rien d’un miracle improvisé. Elle est le prolongement naturel d’une politique intérieure maîtrisée, conçue pour servir d’abord les citoyens du royaume. En attirant d’importants investissements nationaux et étrangers, le Maroc a opéré en quelques décennies une transformation en profondeur, franchissant le cap des pays émergents.
Aujourd’hui, le pays conjugue le confort des standards européens avec la richesse culturelle et les saveurs du Maghreb. Son réseau routier et ferroviaire rivalise avec celui de nombreuses nations développées. Son Train à Grande Vitesse, unique sur le continent, symbolise cette avance technologique et logistique. Les autoroutes quadrillent l’ensemble du territoire, et les infrastructures socio-économiques soutiennent une croissance qui inspire autant qu’elle impressionne.
Du retrait de l’OUA à l’offensive continentale
L’histoire de la politique africaine du Maroc est jalonnée de ruptures, de convictions stratégiques et de repositionnements diplomatiques audacieux. Depuis son retrait fracassant de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1984 jusqu’à sa réintégration calculée dans l’Union Africaine (UA) en 2017, le royaume chérifien a su transformer une posture d’isolement en une stratégie de reconquête douce, mais redoutablement efficace. L’Afrique est devenue, pour Rabat, bien plus qu’un terrain d’affrontement diplomatique : un espace de projection géopolitique, d’expansion économique, d’influence religieuse, et d’affirmation souveraine sur la scène internationale.
En 1984, le Maroc quitte avec fracas l’Organisation de l’Unité Africaine. La raison ? L’admission de la fantomatique République arabe sahraouie démocratique (RASD) au sein de l’organisation continentale. Un affront politique pour Rabat qui considère le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire national. Ce retrait fut l’expression d’un désaccord profond avec la majorité des États africains qui, à l’époque, soutenaient massivement la thèse algérienne du droit à l’autodétermination des habitants de ce territoire.
Pendant plus de trois décennies, le Maroc adopte une posture de marginalité assumée vis-à-vis des instances panafricaines. Mais cette distance ne signifie pas pour autant une absence. En coulisses, Rabat continue à entretenir des liens bilatéraux étroits avec plusieurs pays africains, notamment francophones, en contournant les plateformes multilatérales hostiles à sa position sur le Sahara.
Une diplomatie bilatérale discrète mais active (1984–2010)
Loin de l’arène panafricaine officielle, le Maroc mise sur une diplomatie discrète mais méthodique. Le roi Hassan II, puis Mohammed VI, entretiennent des relations privilégiées avec plusieurs chefs d’État africains, notamment dans la zone ouest-africaine. Rabat tisse des alliances, multiplie les aides techniques, les accords commerciaux et cultive une proximité avec des régimes francophones souvent favorables à sa cause.
Durant cette période, la diplomatie marocaine travaille à saper progressivement la reconnaissance de la fantomatique RASD. Le royaume mène une campagne de délégitimation systématique, réussissant à faire basculer plusieurs pays qui retirent leur reconnaissance à cette entité fantoche. En parallèle, il engage une offensive d’image, investissant dans les services, l’agriculture, la finance et les télécommunications.
La transition Mohammed VI : cap sur l’Afrique
L’accession de Mohammed VI au trône en 1999 marque un tournant décisif. L’Afrique devient progressivement un pilier central de la stratégie diplomatique marocaine. Le roi adopte une démarche proactive : multiplication de visites officielles dans les capitales africaines, signature de centaines d’accords de coopération, renforcement des liens religieux via le soufisme, et émergence de grandes entreprises marocaines sur les marchés africains.
Le Maroc ne se contente plus de défendre sa position sur le Sahara ; il propose un « modèle » de coopération Sud-Sud, centré sur des partenariats gagnant-gagnant. Rabat abandonne la logique de confrontation directe pour celle, plus intelligente, de la séduction, en présentant le royaume comme un pont entre l’Afrique et l’Europe, entre le monde arabo-musulman et le continent noir.
La réintégration à l’Union Africaine en 2017 : un retour calculé
C’est en janvier 2017 que le Maroc fait son grand retour dans le giron africain, en réintégrant l’Union Africaine lors du sommet d’Addis-Abeba. Cette décision n’est pas un aveu de faiblesse, mais le fruit d’un patient travail diplomatique de plus d’une décennie. Le royaume revient avec l’appui de la majorité des pays africains, y compris certains qui avaient traditionnellement soutenu les thèses anti-marocaines.
Ce retour ne signifie pas une reconnaissance de la fantomatique RASD : Rabat le précise d’emblée. Mais il s’inscrit dans une logique pragmatique : mieux vaut être à l’intérieur des institutions africaines pour y influencer les décisions que de rester à l’écart. Le Maroc souhaite surtout éviter que l’Union Africaine ne serve de caisse de résonance au Polisario.
Le redéploiement continental : une stratégie multidimensionnelle
Depuis 2017, le redéploiement du Maroc en Afrique est impressionnant par son ampleur et sa cohérence. Il s’articule autour de quatre axes majeurs :
- L’économie comme moteur d’influence
Les banques marocaines (Attijariwafa Bank, Banque Populaire, BMCE et Bank of Africa), les compagnies d’assurances, les entreprises de BTP, les sociétés de télécommunications (Maroc Telecom), ou encore les opérateurs agricoles ont investi massivement en Afrique subsaharienne. Le Maroc devient un acteur économique de premier plan dans des pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Mali, ou encore le Nigeria.
Le royaume propose des investissements structurants, souvent accompagnés de financements souples et d’un transfert de savoir-faire. Cette politique économique lui permet de se positionner comme un partenaire crédible, sérieux et stable.
- Le soft power religieux
Rabat capitalise sur l’héritage soufi, notamment à travers la Tariqa Tijaniya, très influente en Afrique de l’Ouest. Le Maroc forme des imams africains, finance des centres religieux, et propose un islam modéré, en opposition aux courants salafistes ou wahhabites. Cette diplomatie spirituelle vise à établir un leadership religieux africain à partir de la monarchie marocaine, dont le roi est également le « Commandeur des croyants ».
- La diplomatie royale directe
Le roi Mohammed VI lui-même est au centre de cette stratégie. Il effectue régulièrement des tournées africaines, s’adressant directement aux peuples et aux dirigeants. Ces visites ne se limitent pas à des gestes symboliques : elles sont souvent accompagnées de contrats économiques, de dons, d’accords politiques, et d’initiatives éducatives ou sanitaires.
- Le lobbying politique et diplomatique
Le Maroc s’efforce, via des réseaux diplomatiques et économiques, d’isoler progressivement les séparatistes de la RASD au sein de l’UA. Rabat compte sur l’usure du soutien au Polisario, sur la neutralité croissante de certains États, et sur le basculement de pays clés comme le Nigeria ou l’Afrique du Sud (encore résistant, mais moins catégorique qu’auparavant). Ce travail de sape vise à changer la donne, non pas frontalement, mais patiemment.
- Une stratégie Sud-Sud assumée
Le discours officiel marocain sur l’Afrique se fonde sur le principe de coopération Sud-Sud. Le royaume refuse le paternalisme, prône une égalité partenariale, et insiste sur l’intérêt mutuel. Ce positionnement tranche avec l’approche de certains anciens empires coloniaux ou puissances émergentes.
Le Maroc se positionne aussi comme un pont logistique et diplomatique entre l’Afrique et l’Europe, notamment à travers ses ports (Tanger Med), ses liaisons aériennes (Royal Air Maroc), et ses accords commerciaux avec l’UE. Il est devenu une plaque tournante régionale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des engrais, et du transport.
L’Afrique, un terrain d’avenir stratégique pour le Maroc
De l’isolement diplomatique à l’influence continentale, le Maroc a su transformer une impasse politique en une opportunité géostratégique. Le royaume a compris que l’Afrique est le continent de l’avenir, et s’y est inséré avec méthode, discrétion et ambition. Son retour à l’Union Africaine n’est pas un simple revirement, mais l’aboutissement d’un redéploiement mûrement réfléchi, qui combine enjeux économiques, diplomatiques, religieux et politiques.
Cette présence accrue sur le continent est aussi un levier pour asseoir sa position dans le dossier du Sahara, tout en diversifiant ses partenaires stratégiques au-delà de l’Europe. Si cette politique continue sur sa lancée, le Maroc pourrait bien devenir, dans les prochaines décennies, un acteur incontournable de l’architecture politique et économique africaine.
Sécurité, diplomatie et projets phares
Au fil des décennies, la diplomatie marocaine en Afrique s’est matérialisée par un engagement à la fois stratégique et pragmatique, où la sécurité, la lutte contre les menaces transnationales et le lancement de projets de coopération multiforme occupent une place centrale.
Enjeux sécuritaires et coopération régionale
La lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et la réponse aux défis de l’extrémisme religieux figurent en tête des priorités marocaines. Dès la fin des années 1990, le Maroc a compris que la stabilité du sahel et du pourtour du Sahara conditionne directement sa propre sécurité. Des partenariats remarquables ont ainsi été tissés avec de nombreux pays :
- Mali et Burkina Faso : Rabat a mis en place plusieurs programmes de formation des imams pour promouvoir un islam tolérant face à la montée de groupes radicaux. Des sessions de formation sécuritaire et judiciaire sont également dispensées.
- Guinée, Côte d’Ivoire, Sénégal : Outre la formation religieuse, la coopération touche la police, le renseignement et la sécurisation des frontières. Le Maroc partage des techniques et bonnes pratiques en matière de surveillance, souvent appuyé par ses propres progrès technologiques.
- Nigéria et Ghana : L’accent est mis sur l’échange d’informations pour contrer les réseaux criminels et le trafic de drogue. Le dialogue Maroc-Nigéria s’est, aussi, renforcé avec la création de plateformes mixtes de suivi sécuritaire.
- Corne de l’Afrique (Djibouti, Soudan) : Le Maroc s’est positionné comme médiateur dans des initiatives de paix, apportant un appui logistique à certaines missions de l’Union Africaine ou facilitant le dialogue intergouvernemental en période de crise.
- Afrique du Nord – Libye, Tunisie, Égypte- : Rabat apporte appui technique et coopération en matière de lutte antiterroriste, échange de services d’intelligence et cybersécurité.
Des exercices conjoints, des rencontres institutionnalisées entre forces de sécurité et des plans trimestriels de lutte contre la traite humaine illustrent la profondeur de ces relations.
Projets concrets et partenariats phares pays par pays
- Sénégal : Construction de logements sociaux, ouverture d’universités privées marocaines à Dakar, investissement dans les assurances et grandes infrastructures agricoles ; le Maroc s’impose comme un partenaire global.
- Côte d’Ivoire : La série des « Cités Mohamed VI » ne s’arrête pas au logement : elle inclut hôpitaux, écoles et parcs industriels. Les banques marocaines comme Attijariwafa Bank dominent le secteur bancaire ivoirien.
- Nigéria : Projet géant du gazoduc Nigeria-Maroc, reliant Lagos à Tanger, qui pourrait révolutionner les échanges énergétiques ouest-africains ; création d’un fonds commun pour agribusiness et construction d’une plateforme d’engrais.
- Éthiopie : Implantation d’une méga-usine d’engrais à Dire Dawa, plus grande usine de ce type, sur le continent, portée par OCP ; échanges universitaires et renforcement des liaisons aériennes (RAM).
- Gabon : Partenariat dans l’industrie du bois, projets dans la santé, le logement et la microfinance ; implication du Maroc dans le secteur hospitalier de Libreville.
- Cameroun : Accompagnement du secteur agricole, dispositifs pour la formation technique et partenariat sur l’assurance agricole.
- Angola et Mozambique : Ouverture d’ambassades et accords de coopération dans la logistique, l’éducation, le transport aérien.
- Afrique du Sud : Malgré les divergences politiques, plusieurs conventions économiques ont été signées, notamment dans les mines et la finance ; présence très active des entreprises marocaines sur le marché sud-africain.
Ces partenariats s’inscrivent dans une volonté de rayonnement régional et d’exemplarité, illustrée à la fois par l’engagement du Maroc dans les politiques de développement et par sa capacité d’adaptation face aux défis sécuritaires. Rabat entend asseoir un leadership africain, à la fois pragmatique, solidaire et innovant.
La stabilité des institutions : socle de la réussite diplomatique marocaine
La reconquête progressive et méthodique du continent africain par le royaume du Maroc, que nous venons de passer en revue, ne saurait être comprise sans mettre en lumière le facteur central qui en a garanti le succès : la stabilité des institutions et la solidité des cadres appelés à en piloter les grandes orientations.
Cette stratégie ambitieuse, structurée et visionnaire, porte l’empreinte directe du roi Mohammed VI. Elle repose sur une architecture politique et diplomatique à la fois fluide et cohérente, où la continuité de l’action prévaut sur les aléas du temps et des alternances gouvernementales. Deux figures de proue incarnent cette ligne de continuité : Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et Yassine Mansouri, directeur de la DGED (Direction Générale des Études et de la Documentation), fer de lance de ce que l’on appelle la diplomatie parallèle. Tous deux jouissent de la pleine confiance du souverain, qui les maintient à leurs postes depuis de nombreuses années, preuve de la confiance royale dans la constance et la compétence.
C’est là une différence fondamentale avec d’autres systèmes où la diplomatie change de cap au gré des coalitions politiques ou des échéances électorales. Le Roi Mohammed VI, en fin stratège, a tenu à garder sous son autorité directe ce levier sensible qu’est la politique étrangère. C’est lui qui nomme le ministre des Affaires étrangères, trace les grandes lignes de sa mission, et supervise l’action des services extérieurs de l’État, y compris les volets économiques, sécuritaires et culturels de l’action diplomatique.
Le choix de Nasser Bourita à la tête de la diplomatie n’a, donc, rien d’anecdotique. Il est le fruit d’un parcours exemplaire et d’une fidélité constante à l’institution. Né en 1969, ce haut fonctionnaire entame sa carrière au ministère des Affaires étrangères à l’âge de 23 ans. Très tôt, il fait preuve de rigueur, de finesse d’analyse et d’un sens élevé de l’État. Il gravit méthodiquement les échelons, occupant divers postes à haute responsabilité jusqu’à être nommé secrétaire général du ministère en 2011, puis ministre des Affaires étrangères le 5 avril 2017.
Son style sobre, sa maîtrise des dossiers complexes et son engagement sans faille dans la mise en œuvre des orientations royales en font un pilier de la diplomatie marocaine contemporaine. Loin des effets d’annonce, il incarne une diplomatie marquée par le sérieux, la rigueur et le pragmatisme.
Quant à Yassine Mansouri, à la tête de la DGED, il agit dans l’ombre mais avec une efficacité remarquable. Son action discrète mais décisive contribue à faire rayonner l’image du Maroc en Afrique et au-delà, en s’appuyant sur des réseaux d’influence solides, une connaissance fine des réalités régionales, et une intelligence stratégique rarement prise en défaut.
C’est donc cette alliance entre vision royale, stabilité institutionnelle et excellence des cadres qui constitue le moteur profond de la réussite marocaine en Afrique. Une réussite que confirment les résultats, les partenariats conclus, et le respect croissant dont jouit le Maroc sur l’échiquier continental et international.





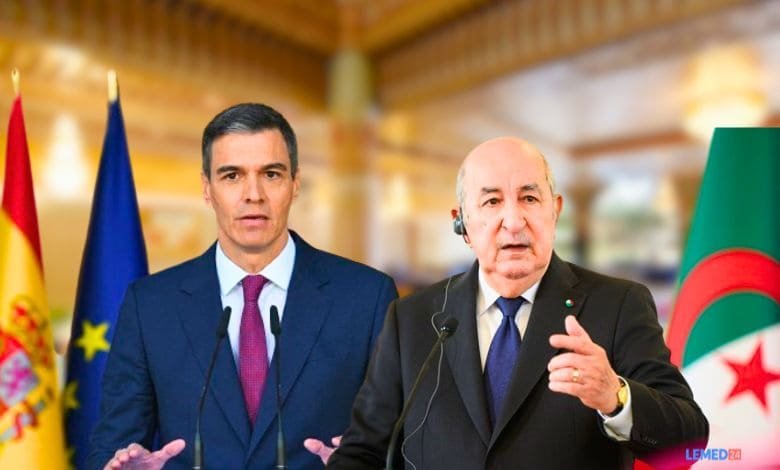
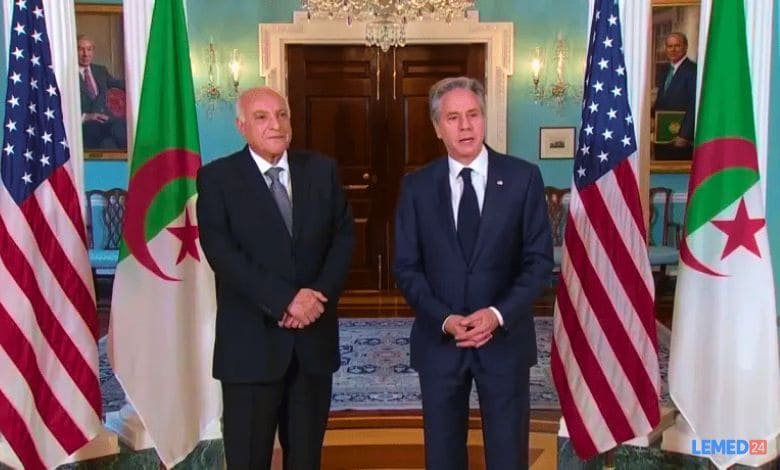
mes respect a monsieur Hicham about Un Homme Intègre Un Algérien pur sucre grand patriote qui aime son pays franchement c’est dommage pour l’Algérie qui mérite un dirigent de cette pointure a La place des voyous nautoires qui ont massacrés l’Algérie du fond en comble